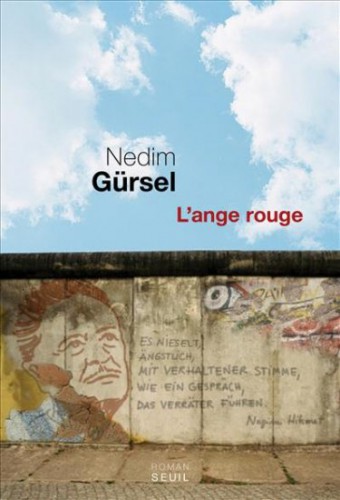La dernière fois que je vous ai parlé d’Orhan Pamuk, j’avais signalé ce musée ouvert à Istanbul l’an dernier d’après Le musée de l’Innocence (2006, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy en 2011). J’ai refermé ce roman de huit cents pages en m’interrogeant : quelle mouche a piqué l’écrivain pour bâtir une histoire aussi kitsch et son « produit dérivé » en quelque sorte ?
 http://www.zamanfrance.fr/article/mus-e-orhan-pamuk-nomin-design-l-ann-e
http://www.zamanfrance.fr/article/mus-e-orhan-pamuk-nomin-design-l-ann-e
C’est l’histoire d’un amour malheureux aux yeux des autres mais « le plus heureux » du point de vue de son narrateur, un jeune homme riche de trente ans qui va bientôt se fiancer devant la meilleure société stambouliote, à l’hôtel Hilton, avec une jeune femme « que tout le monde trouvait parfaite ». Mais au « moment le plus heureux » de sa vie, le lundi 26 mai 1975, il vient d’embrasser l’épaule d’une cousine éloignée, dix-huit ans, qui l’a suivi dans sa garçonnière et y perd une boucle d’oreille au cours de leurs ébats.
Füsun travaille comme vendeuse dans une boutique ; Kemal, qui avait « quasiment oublié son existence », a rencontré sa cousine en y achetant un sac pour sa fiancée. Parente pauvre, « la fille de Nesibe » s’est déshonorée en participant à un concours de beauté. Mais Sibel refuse le sac, une imitation selon elle, et en le rapportant au magasin, Kemal trouve encore plus de charme à la belle Füsun. Sous le prétexte de lui donner des cours de maths, il la retrouve dans l’appartement de l’immeuble Merhamet où sa mère dépose les choses dont elle n’a plus besoin : ils y vont régulièrement pendant un mois et demi et leur entente charnelle les enivre tous deux.
Imbroglio sentimental : agissant comme si de rien n’était avec sa fiancée, Kemal est l’amant comblé de Füsun – on se doute que ce bonheur ne durera pas toujours. Liaison secrète et mensonges n’ont qu’un temps. Mais les détours de l’intrigue proposent une autre piste de lecture : tous les détails de la vie des Turcs dans l’Istanbul des années 70 et 80, leurs habitudes quotidiennes, leurs rituels, leurs codes. Kemal, après des études de management en Amérique, travaille comme son frère aîné dans l’entreprise paternelle « de distribution et d’export ».
Dans la société turque de cette époque, la femme se doit de rester vierge avant le mariage. Les jeunes les plus européanisés aimeraient plus d’audace et de modernité, mais les filles avec qui on couche ne sont pas celles avec qui on se marie. C’est au cinéma qu’ils découvrent d’abord comment on embrasse – l’univers des films est un autre thème du Musée de l’Innocence, avec ses distinctions entre films occidentaux et turcs, films d’art et mélodrames – Fûsun rêve de devenir actrice. La tension entre culture européenne et tradition est un leitmotiv.
Istanbul est omniprésente dans ce roman, avec ses « rues, ponts, ruelles en pente et places », ses quartiers, ses restaurants, ses bars et, dans les années 80, ses manifestations et émeutes. Les paysages du Bosphore, le passage des bateaux, les terrasses… Du balcon de leur vaste appartement, Kemal et ses parents assistent volontiers aux cortèges de funérailles dans la cour de la mosquée voisine, « un spectacle à ne pas manquer ».
Mais Le Musée de l’Innocence est en même temps un hymne aux objets qui peuplent la vie quotidienne des amoureux. Il y a du Perec – « La vie mode d’emploi », « Les choses », « Je me souviens »… – dans ce roman. Le chapitre 69, « Parfois », ne contient que des phrases contenant cet adverbe. L’attitude du narrateur évoque par ailleurs la recherche proustienne du Temps et du Bonheur, Kemal est un amoureux jaloux à la façon de Swann ou de l’amant d’Albertine.
Tout au long du récit, le lecteur est renvoyé au futur Musée où tous les objets cités trouveront leur place, témoins d’un bonheur inoubliable, du plus précieux au plus banal (des barrettes à cheveux jusqu’aux mégots des cigarettes fumées par Füsun !), y compris ceux subtilisés chez les parents de Füsun auprès de qui Kemal va « s’asseoir » régulièrement (façon turque de « rendre visite »). L’accumulation fétichiste est ici « collection », le « musée sentimental » – 83 vitrines pour 83 chapitres – sera lui-même conçu sur le modèle des milliers de musées visités par lui dans le monde entier. « J'ai écrit le roman tout en collectionnant les objets que je décris dans le livre », a précisé l’auteur.
« La consolation des objets » croît avec l’obsession du narrateur. Füsun disparaît. Kemal, jour après jour, l’attend : la présence des objets qu’elle touchait dans l’appartement, la manipulation des choses qu’elle aimait apaisent un peu sa souffrance. Il finit par se rendre chez sa tante pour avoir de ses nouvelles. Füsun a raté ses examens, elle a quitté son travail, et son père l’a emmenée loin pour qu’elle oublie son cousin ; lui devrait l’oublier aussi.
Je vous laisse découvrir la suite – mélodramatique, avec la rupture des fiançailles et la réapparition de Füsun, mariée à un autre –, une longue errance mélancolique imbibée de raki, ruineuse pour la réputation du héros, éprouvante pour le lecteur impatient, semblable peut-être à ces films turcs « traitant de la vie et de ses tourments » que le public suit en décortiquant des graines de tournesol. Lisez la table des matières si vous voulez vous en faire une idée.
Pamuk multiplie les mises en abyme : le père de Kemal a lui aussi entretenu une maîtresse en secret pendant onze ans. L’histoire de Nurcihan et Mehmet, que tout le monde voudrait voir mariés, est une sorte de réplique aux amours de Kemal et Sibel. Kemal devient le producteur d’un film intitulé « Vies brisées »...
L’auteur apparaît pour la première fois dans le récit lors de la somptueuse fête des fiançailles entre Kemal et Sibel. Ce jour-là, Orhan Pamuk (issu d’une riche famille en partie désargentée et mal à l’aise face aux nouveaux riches) danse même avec Füsun. A la fin du roman, c’est à lui que le narrateur s’adresse pour lui demander de raconter son histoire, en guise de « catalogue » du futur Musée de l’Innocence, et de la conclure.
 « Le vingtième siècle attendait beaucoup des écrivains, des poètes, des penseurs qui vibraient à l’unisson. Ils devaient écrire des livres, entonner des chants, montrer la voie, éclairer le peuple et, revêtus de l’habit d’« ingénieurs des esprits », fonder un nouvel ordre mondial. Jusque-là, les penseurs s’étaient contentés d’interpréter le monde, désormais ils avaient pour mission de le changer. Ils devaient sauver tout d’abord le pays, puis l’humanité tout entière. Et moi, presque cent ans plus tard, bien incapable de sauver l’humanité, je ne pouvais même pas me sauver moi-même. J’étais là pour un poète. En fait, j’essayais de rassembler les morceaux épars d’une vie. C’était comme reconstituer un puzzle. »
« Le vingtième siècle attendait beaucoup des écrivains, des poètes, des penseurs qui vibraient à l’unisson. Ils devaient écrire des livres, entonner des chants, montrer la voie, éclairer le peuple et, revêtus de l’habit d’« ingénieurs des esprits », fonder un nouvel ordre mondial. Jusque-là, les penseurs s’étaient contentés d’interpréter le monde, désormais ils avaient pour mission de le changer. Ils devaient sauver tout d’abord le pays, puis l’humanité tout entière. Et moi, presque cent ans plus tard, bien incapable de sauver l’humanité, je ne pouvais même pas me sauver moi-même. J’étais là pour un poète. En fait, j’essayais de rassembler les morceaux épars d’une vie. C’était comme reconstituer un puzzle. »